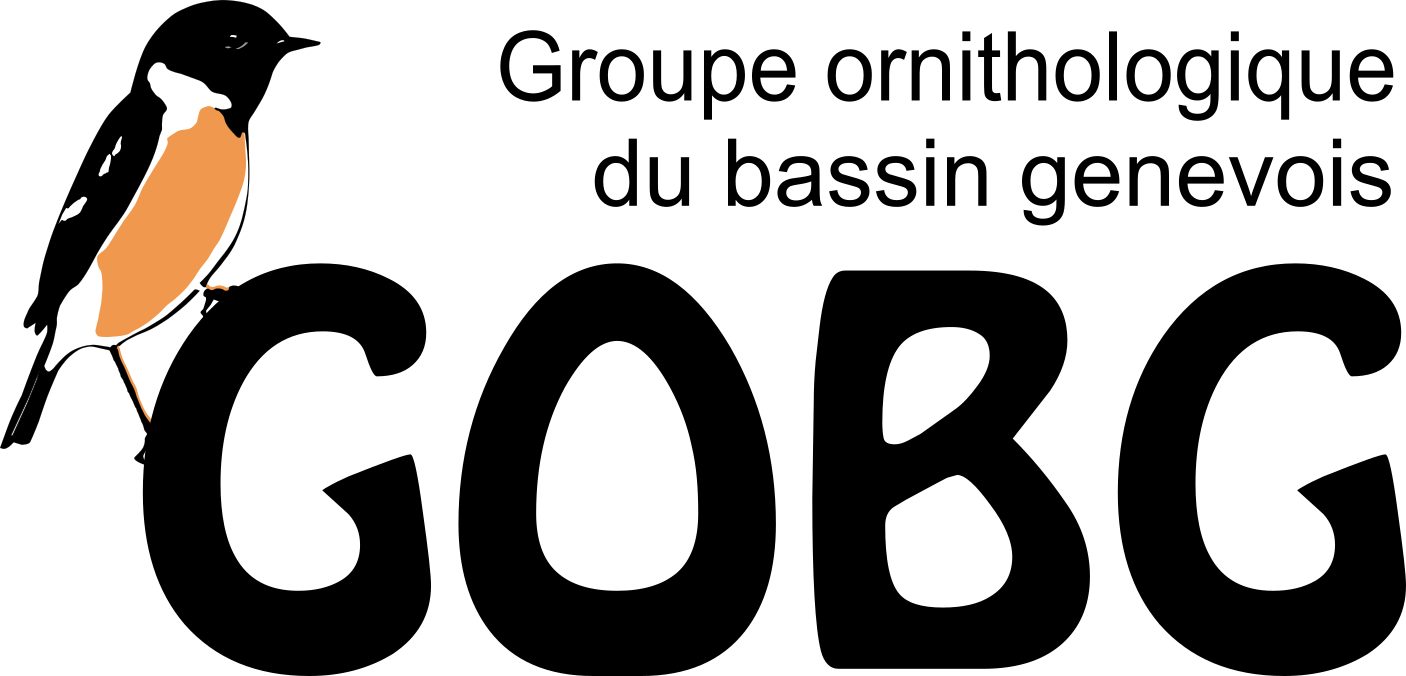La Chevêche a la pêche !
Chevêche d’Athéna - ©Christian Fosserat
Parmi les espèces suivies par le GOBG, l’année 2024 particulièrement contrastée nous invite à faire un « focus » sur la Chevêche d’Athéna, après près de 30 ans de suivi.
Année contrastée, d’une part, par la 2ème partie du printemps très humide, impactant directement les résultats de reproduction de l’espèce. Certaines nichées ne sont pas arrivées à terme, la faute à des cavités de reproduction très humides. Cette insalubrité d’une partie des gîtes (y compris des nichoirs) s’explique bien sûr par les pluies et le temps frais. Mais à cela s’est probablement ajouté un paramètre alimentaire : en période pluvieuse, les vers de terre représentent une proie abondante, que les chevêches - opportunistes – vont largement exploiter. Les poussins contribuent alors à renforcer l’humidité du nid avec des fientes très liquides, les lombrics étant composés à 80-90 % d’eau.
D’autre part, dans un registre nettement plus positif, 2024 est à marquer d’une pierre blanche pour ses effectifs record, qui ont franchi un nouveau palier symbolique, avec plus de 80 territoires. Plus précisément, le décompte atteint 82 territoires, dont 45 entre Arve et Lac.
La figure ci-dessous illustre l’évolution des effectifs de l’espèce à Genève depuis 1996. La courbe rouge met en évidence l’importance du secteur précité dans la progression, alors que les autres secteurs du canton ont totalisé des effectifs plus ou moins stables durant 30 ans.
Comment expliquer cette évolution positive, a priori inhabituelle dans le contexte général d’érosion de la biodiversité ? Assurément, les causes sont multiples. Sans apporter de réponse à la spécificité de la progression entre Arve et Lac – on peut évoquer quatre différents facteurs qui ont sûrement contribué au maintien et à la progression de l’espèce à l’échelle du canton (et de certaines régions limitrophes) en trois décennies.
L’un d’eux est le réchauffement climatique. Jusqu’à présent, il est probable que les deux dernières décennies, globalement plus chaudes, ont favorisé la chevêche. L’espèce est notamment sensible aux couvertures neigeuses prolongées, situations de plus en plus rares en plaine.
Un second aspect concerne l’évolution de l’agriculture. En plus de deux décennies, les surfaces de promotion de la biodiversité se sont accrues (prairies extensives, jachères, haies basses) ; il en est de même pour leur qualité biologique. Globalement, les pratiques agricoles ont positivement évolué concernant l’usage des phytosanitaires, notamment en termes de dosage et d’effets collatéraux[1], même si des nouveaux produits phytosanitaires nous rappellent que la problématique n’est pas toujours sous contrôle (cas des néonicotinoïdes, par exemple). Les modes culturaux dits intégrés, bio ou de conservation (sans labours) se sont étendus, notamment dans la campagne genevoise. Même s’il est difficile de quantifier l’importance de ces changements vis-à-vis de la biodiversité, les indicateurs biologiques - comme les effectifs des oiseaux « agricoles » - démontrent clairement une évolution positive pour 2/3 des espèces[2]. Face à une situation autrement moins positive sur le Plateau suisse, il y a tout lieu de se réjouir de cette « Genferei » pour une fois (?) positive. Et rien n’empêche d’espérer mieux, de s’inspirer de ces succès et de poursuivre ce travail concerté entre agriculture et biodiversité.
La pose des nichoirs a également contribué à renforcer les effectifs de la chevêche. Cet effet a été mis régulièrement en évidence ces dernières années, par l’installation de couples sur des territoires précédemment inoccupés, ceci peu de temps après la pose de nichoirs. Ces trois dernières décennies, nous avons pu identifier des habitats paraissant favorables (structures végétales variées, arbres épars, terrains de chasse potentiels) mais où l’offre en cavités paraissait faible ou nulle. Nous avons alors petit à petit complété l’offre en nichoirs. Les présences subséquentes de la petite chouette ont confirmé le potentiel de ces sites. Bien sûr, l’idéal serait une campagne riche en cavités naturelles, et sans nichoirs... Mais « faute de mieux », il semble pertinent d’utiliser ces succédanés rectangulaires jusqu’à nouvel ordre.
Finalement il est aussi probable que dans le cas de la chevêche, espèce sédentaire au taux de reproduction plutôt faible, la démographie soit influencée par des cycles pluriannuels de population, tantôt aggravés par des facteurs limitants forts, ou à l’inverse renforcés par des conjonctions favorables. Le « creux » du début des années 2000, suivi de la dynamique positive qui s’est instaurée ensuite, refléteraient ces fluctuations. La reprise s’est notamment appuyée sur des succès de reproduction élevés plusieurs années de suite. Sachant aussi que l’espèce à une propension à s’installer volontiers à côté du couple voisin (on parle de noyaux de population), des reconquêtes locales « par poches » se sont petit à petit dessinées, sûrement plus pérennes que des couples isolés. Peut-être que le « trou » momentanément béant entre Arve et Lac au milieu des années 2000 a facilité l’enclenchement d’une telle dynamique, elle-même appuyée par une immigration d’oiseaux en provenance d’autres secteurs du canton, mais sûrement (et surtout ?) de la proche Vallée de l’Arve.
Toutes ces hypothèses plutôt globales sur l’évolution récente de la Chevêche d’Athéna dans le canton de Genève n’expliquent toutefois que (très) partiellement l’essor particulier de l’espèce entre Arve et Lac, par rapport à la stagnation des effectifs ailleurs. Les évolutions de l’agriculture, évoquées précédemment, ont peut-être aussi porté plus fortement cette reprise locale. Le secteur en question abrite encore une proportion plutôt élevée de vieux chênes bordant des prairies extensives et des cultures. Une analyse fine de l’évolution historique de ces surfaces pourrait peut-être montrer des corrélations avec l’évolution des effectifs. Une telle étude serait certainement intéressante, mais chronophage et complexe à mener.
Dans une vision pragmatique et rationnelle, il est probablement plus important de se tourner vers l’enseignement que nous apporte l’existant, à savoir les liens entre la présence de l’espèce et la qualité des milieux, et de capitaliser sur ces constats.
Plus que jamais, il nous semble essentiel de trouver les meilleurs consensus entre agriculture, biodiversité, paysage et aménagement. Les défis de demain sont sûrement plus importants encore que ceux d’aujourd’hui, dans un contexte où l’espace devient de plus en plus contraint, notamment soumis au développement du bâti et des infrastructures.
Dans le domaine de la réduction de la pollution lumineuse, les collectivités démontrent que l’on peut prendre des mesures importantes et plutôt rapides sur le domaine public (cas du programme OptimaLux et d’initiatives communales). C’est encourageant et inspirant. On peut espérer que ces efforts seront encore amplifiés par des initiatives privées de plus en plus nombreuses.
Dans la thématique de l’agroécologie, des initiatives se développent ici et là, dans certains cas avec un engagement significatif de certaines communes. Le GOBG peut et doit y contribuer, que ce soit pratiquement (plantation de haies) ou financièrement. Notre association doit également poursuivre son travail de sensibilisation et d’appui auprès de tous les acteurs. Dans le cas de la Chevêche d’Athéna et des espèces « agricoles », il importe de renforcer encore les liens avec l’agriculture et les collectivités publiques. C’est d’ailleurs un des enjeux forts d’un nouveau programme commun que nous développons avec BirdLife Suisse. Nous vous en reparlerons prochainement !
Christian Meisser, 30.01.2025
[1] On peut notamment rappeler le DDT, qui s’était révélé très nocif pour les rapaces. Il a été interdit en 1972 en Suisse.
[2] OCAN (2020) : Réseaux agro-environnementaux genevois. Synthèse cantonale du suivi biologique 2016-2017 et 2019.
Rapport complet et synthèse consultables sur internet