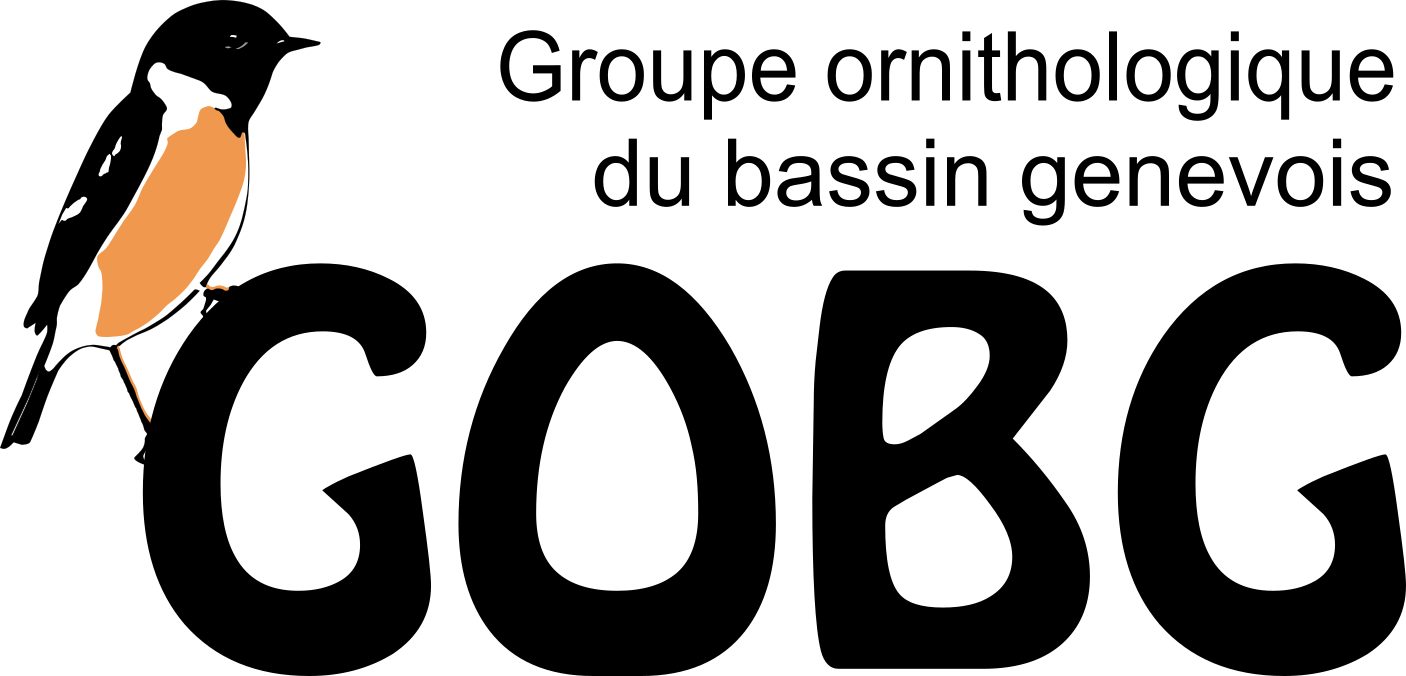Réponses à notre son et à notre photo mystères n° 37
Il s’agit du chant et des cris du Pic mar (Dendrocopos medius). Cette espèce de pic est souvent confondue avec le Pic épeiche. Au contraire de ce dernier, il possède un vrai chant et ne martèle pratiquement pas.
Son chant, qui retentit dans les forêts dès janvier ou février, est un chant nasillard et plaintif qui rappellent un peu les cris du Geai des chênes.
Les cris ressemblent à ceux du Pic épeiche, mais ils sont émis en une série de sons rapides enchaînés, dont le premier est plus aigu (tik teuk teuk teuk…). Les cris du Pic épeiche sont en revanche plus isolés. Dès qu’il s’installe dans son lieu de nidification, qui n’est pas forcément celui d’hivernage, il devient plus discret. Lorsque la ponte intervient, il devient presque silencieux et peut ainsi nicher sans être repéré.
Sonagramme = empreinte du son de l’enregistrement
L’image à identifier
Photo : André Bossus
Il s’agit du Tarin des aulnes (Carduelis spinus), reconnaissable à sa calotte noire, ponctuée de gris en automne chez le mâle. Sa poitrine et son croupion sont jaunes verdâtres non striés. Le bec conique est gris ou brunâtre. Il s’agit ici d’un mâle car la femelle n’a pas de noir sur la tête.
De dos, le tarin est facilement reconnaissable à ses ailes foncées à motif contrastant jaune ou blanc jaunâtre. Le bas des flancs est fortement strié.
Chez le mâle, la taille de la bavette est un signal extérieur très visible qui représente un rang social déterminé. En effet, ce ne sont pas forcément les oiseaux les plus âgés qui arborent les bavettes les plus larges, mais bien les sujets dominants. Ainsi, une hiérarchie sociale s’installe parmi les membres des différents groupes formés de 10 à 50 individus, qui se côtoient durant l’hiver, époque durant laquelle ils sont très mobiles.
Les Tarins des aulnes ont une activité incessante tout au long du jour. Ils passent des heures, perchés la tête en bas, accrochés aux fins rameaux des aulnes et des bouleaux pour en extraire les graines.