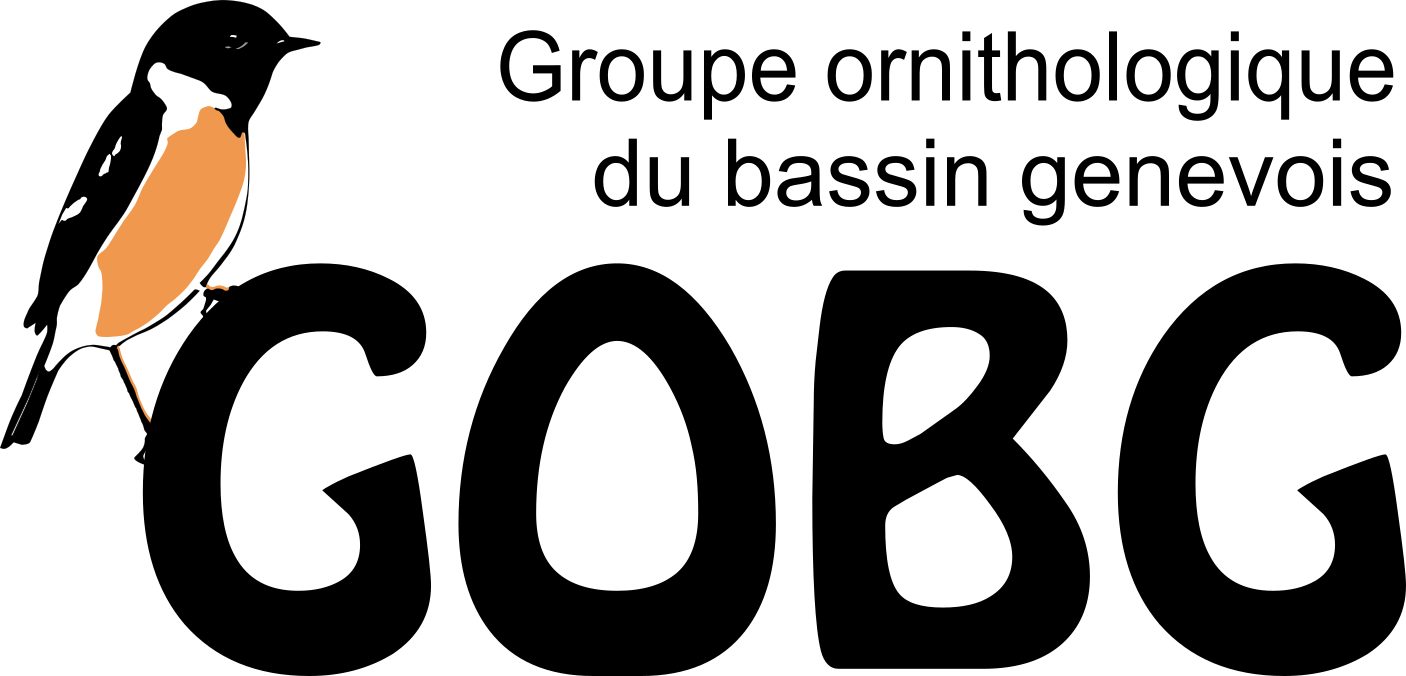16 juillet 2022 : Les nicheurs du plateau d’Anzeindaz
Nous avons rendez-vous à Solalex à 7h30. Certains-es sont déjà sur place après une nuitée à l’auberge. Pour les autres, c’est co-voiturage.
La journée s’annonce belle et ensoleillée, pas l’ombre d’un nuage. Il va faire chaud. Comme dit Jean-Daniel, il n’y a que les ornithologues qui sont capables de sortir par une journée aussi chaude. A Solalex, il fait 13°, une fraîcheur bienvenue.
Nous sommes tous très heureux de nous revoir pour profiter de notre merveilleux rendez-vous ornithologique. Nous sommes rapidement mis dans l’ambiance. Après un court passage dans la verdure des alpages, nous voilà dans la forêt clairsemée essentiellement de sapins et les premiers oiseaux se font déjà entendre et/ou apercevoir. La Mésange boréale alpestre, la Grive draine ou le Bouvreuil pivoine, pour en citer quelques espèces.
Nous longeons le torrent, l’Avançon d’Anzeinde, qui déverse une quantité d’eau relativement modeste. Les flots scintillent sous les premiers rayons de soleil. Nous sommes fascinés par la géologie qui nous entoure. Nous avons la chance d’avoir parmi nous Jean-Luc pour ses compétences professionnelles en géologie. Les différentes strates se superposent comme la pâte d’un millefeuille géant. Chaque couche de 15cm représente 30'000 ans d’évolution. Nous distinguons au sud l’Arrête d’Argentine pour ne citer que la crête la plus connue. Nos regards sont attirés par des volatiles difficilement identifiables en vol. Voilà que l’un d’eux se pose sur un saule de la rive gauche du torrent. Nous avons le plaisir d’identifier un Venturon montagnard femelle, rapidement rejoint par son mâle. Pour certains d’entre nous, c’est la première fois que cette espèce est observée.
Notre sentier régulier et facile est bientôt traversé par un important éboulement. La masse de rochers provient d’un sommet nord. Une machine de chantier nous fait comprendre l’importance du volume à déplacer pour remettre en place, tant notre sentier que la route qui mène à l’alpage d’Anzeinde. Cette route est un accès qui permet de ravitailler le refuge Giacomini, la cabane Barraud, sans oublier les agriculteurs qui ont leurs vaches sur cet alpage, qui paraît-il, est le plus grand du canton de Vaud.
Après avoir quitté la forêt, voilà qu’une petite dizaine de chèvres brunes, sympathiques, pas farouches du tout et gourmandes de nos lacets, nous accompagnent. Elles ne nous empêchent pas d’observer entre autres avec grand plaisir des Traquets motteux, des Pipits spioncelles et parfois des Niverolles alpines. Arrivés au refuge, nous prenons congé de nos accompagnatrices. Sur les sommets, quelques Chocards à bec jaune. Les Rougequeues noirs sont de la partie. André mentionne qu’ils colonisent chaque parcelle de 10km2 de notre pays, excepté quelques glaciers. C’est l’espèce la plus répandue de notre pays. Belle capacité d’adaptation à l’espèce humaine omniprésente sur notre planète.
Photos : Couple de Traquets motteux (©J.-L. Loizeau), poussin de Lagopède des Alpes (©J.-D. Macherel) et jeune Traquet motteux (©P. Dumusc)
Femelle de Lagopède des Alpes - Photo : ©J.-D. Macherel
Nous arrivons vers 12h00 à Paneirosse sur un des spots à Lagopèdes alpins recommandé par Jérémy. Rien n’est moins sûr de le trouver. En chemin, nous entendons les cris d’un Faucon crécerelle. En levant les yeux, nous avons la surprise d’observer cet oiseau qui pourchasse un Aigle royal juvénile. Aucun des deux ne repassera. A peine arrivé à l’endroit prévu, voilà que Jean-Daniel est le premier à apercevoir derrière un rocher une tête dépasser. C’est une femelle Lagopède alpin au plumage d’été. Difficile pour Jean-Daniel d’attirer notre attention sans faire de bruit. La communication non verbale déploie tous ces effets. Nous sommes tous excités comme de jeunes enfants de l’apercevoir. Nous restons aussi discrets que possible. Nous nous concertons pour largement contourner l’oiseau avec l’espoir de mieux le distinguer. Quelle n’est pas notre surprise à l’instant de quitter le sentier : quatre oisillons s’envolent devant nos pieds. Nous avions l’impression d’avoir presque marché dessus. Nous les avons dérangés sans bien sûr le vouloir. Nous effectuons un détour avec la sincère volonté de ne pas les effaroucher. Nous nous asseyons cinquante mètres plus haut sur un long rocher. Plus personne ne bouge, ne parle, nous attendons. En moins de 5 minutes d’attente, la mère des petits pointe son bec, elle joue à cache-cache avec nos yeux en se dissimulant derrière des rochers ou des touffes d’herbe. Nous la sentons inquiète de ne pas les voir. La voilà qu’elle les appelle. C’est une chance considérable, car il est peu courant de l’entendre. Nous écoutons distinctement ses petits cris.
Après ces émotions partagées par toutes et tous, il est temps de pique-niquer sur une butte au loin. Nous avons un très joli panorama et sommes entourés par des fleurs de montagne qui commencent déjà à monter en graines. Ici, à environ 2000m d’altitude, la flore doit faire vite pour se reproduire. L’été est très court. Encore une surprise, un joli Edelweiss* se présente à nous. Étonnamment, elle est solitaire.
Après cette agréable petite pause et sieste, nous descendons en direction du refuge. Un détour est fait par le Roc de la Vache pour rejoindre le Pas de Cheville. La journée s’est encore une fois déroulée avec l’enthousiasme de tous les participants-es et dans une sympathique ambiance. Nous avons eu une belle qualité d’observation plutôt que de nombre (24 espèces observées). Le Gypaète ou la Perdrix bartavelle n’ont pas montré leur bec. Ce sera sans aucun doute pour une autre fois !
Un grand merci à Jérémy pour l’organisation et à qui nous souhaitons un bon rétablissement, et à nos guides pour la finalisation de cette sortie, ainsi que pour le partage de leurs connaissances, grand privilège pour nous tous.
Auteur : Jean-Pierre
* La colonisation des reliefs européens par l'Edelweiss a été permise par le retrait des glaciers suite à la dernière période glaciaire. De plus, sur la trentaine d'espèces appartenant au genre Leontopodium, seules deux espèces sont strictement européennes (Leontopodium alpinum et Leontopodium nivale), alors que les autres espèces se répartissent en Asie, essentiellement dans l'Himalaya et sur les hauts plateaux désertiques chauds et arides du Tibet, suggérant que les espèces européennes se soient différenciées à partir d'espèces d'Asie du sud-est suite à une colonisation initiale d'origine asiatique. Les études génétiques récentes menées par C. BLÖCH et collaborateurs (2010) à partir des séquences d'ADN ribosomiques nucléaires et plastidiaux d'espèces européennes et asiatiques de Leontopodium ont permis d'établir le lien de parenté étroit entre les espèces européennes et asiatiques, ainsi que la monophylie du genre Leontopodium, et de proposer une différenciation récente des espèces européennes à partir d'espèces parentes tibétaines. La colonisation des Alpes par des espèces originaires d'Asie ne concerne pas seulement l'Edelweiss, elle a été démontrée pour les soldanelles, les gentianes et les rhododendrons. (Source)